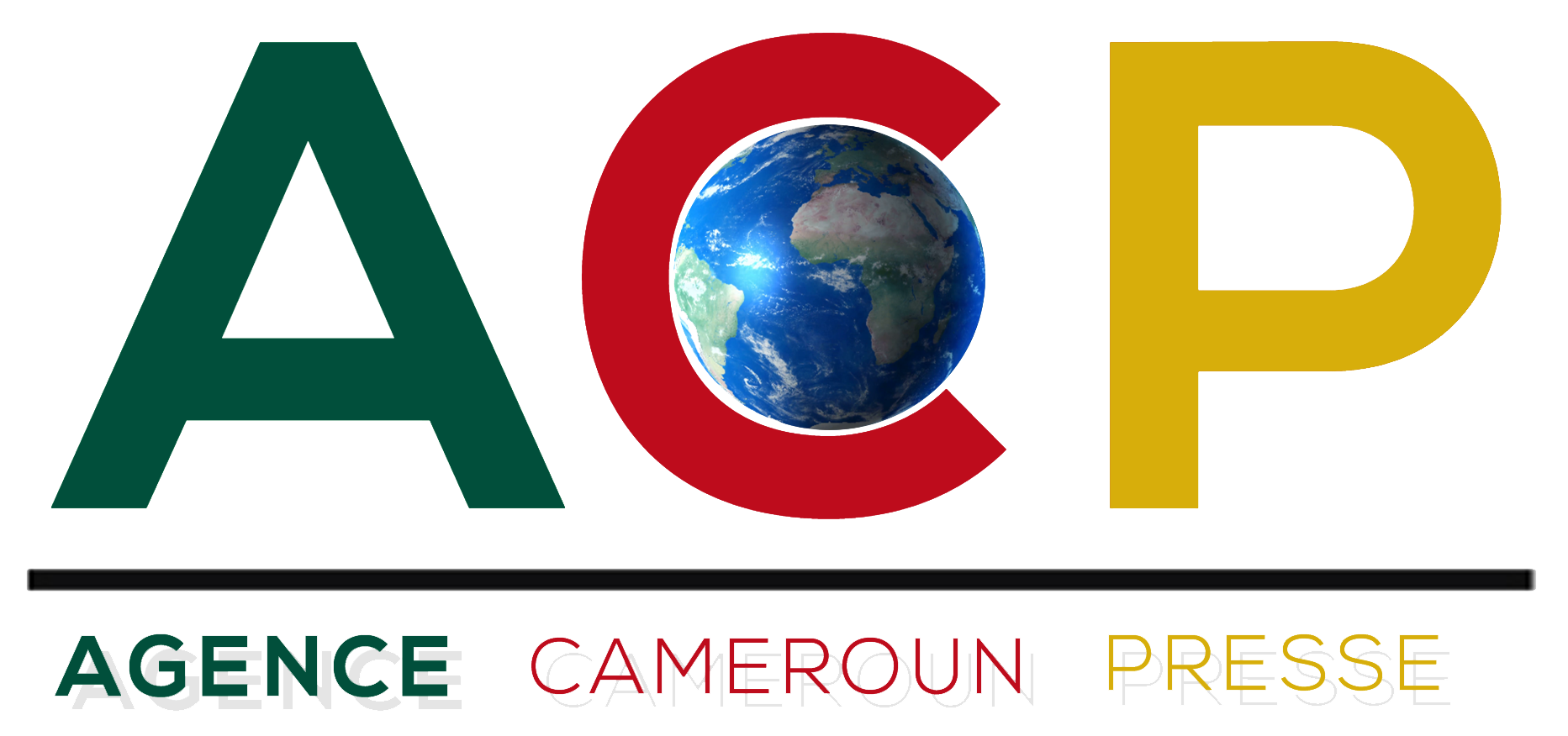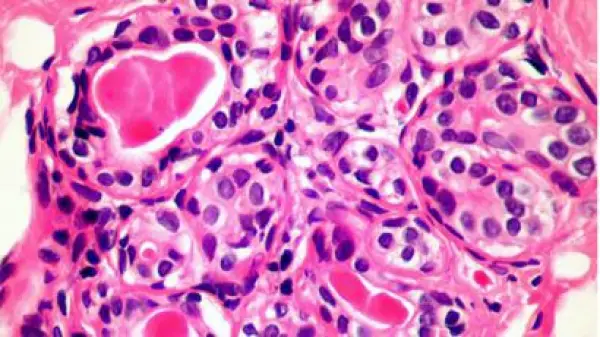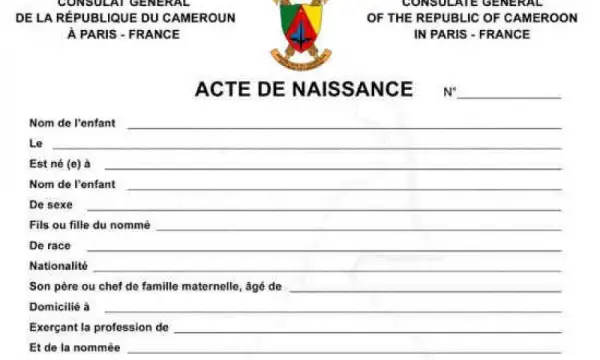Par Fridolin Nke - Expert du discernement
Le 29 novembre 1983, à Yaoundé, un an après l’accession du Président Paul Biya au pouvoir, Marcien Towa écrit un texte à l’intention de la famille philosophique africaine, et sans doute à l’adresse de son camarade devenu Président : « La primauté du bien commun doit être posée aux dépens de la recherche fiévreuse ou de la préservation de privilèges matériels ou sociaux. En recevant récemment l’Ambassadeur d’Ethiopie, le Président de la République a eu ce mot à la fois très simple et très profond : « Dans l’adversité, nous devons serrer les rangs ».
Or une société qui s’organise systématiquement sur la base de privilèges économiques, sociaux et politiques, sème par là même les germes de divisions et de conflits. La crise que nous venons de traverser n’a sans doute pas eu d’autres cause. La nécessité de serrer les rangs pour surmonter une adversité déjà multiséculaire, et qui plonge ses racines dans un système mondial d’asservissement et d’exploitation, ne nous accule-t-elle pas à nous mobiliser autour d’un projet de société excluant privilèges, oppression et exploitation ?
Il ressort de cette remarque introductive que le gouvernement de la cité est un exercice de rassemblement des forces et énergies de tous les membres de la collectivité pour penser les aspirations de la nation, tracer la voie de la prospérité et les ériger les remparts contre les ennemis du dehors. Les hommes politiques, dès lors, travaillent à garantir à leurs concitoyens de vivre dans la concorde et à s’assurer que la législation nationale soit protégée contre toute atteinte. Ce principe est théorisé par Spinoza dans son Traité de l’autorité politique.
Il y démontre que l’action de tout homme d’État ne saurait consister à tendre des embûches aux hommes, mais plutôt à les servir utilement dans leurs aspirations fondamentales. De même, soutient-il, les actes des gouvernants devraient toujours être inspirés par les prescriptions de la raison, et non point par la ruse.
Pour ce faire, il faut que le souverain mérite la patrie qu’il gouverne. Le souverain dont la renommée traverse le temps et impacte les générations entières est ou éclairé ou impitoyable, parfois les deux à la fois, mais jamais borné. C’est un bâtisseur et un esprit non accommodant. En aucun cas, il ne saurait se présenter sous les traits d’un sujet pusillanime qui s’accommode d’expériences ordinaires, d’options provisoires ou de glissements de chronogramme dans son programme d’action.
Au contraire il cultive une posture stoïque, empreinte d’ascèse, de frugalité, voire de chasteté. C’est un motif de fierté pour son peuple, car il répugne aux simplicités ludiques et au satanisme imposé par les énergies réactionnaires de l’intérieur, et les assauts des forces étrangères. Dévouement, sacrifice, discipline des envies, entretien du bon goût, vision prospective dans la durée, telles sont les traits caractéristiques de son engagement patriotique quotidien.
Penser les modalités, les ressorts et les enjeux du gouvernement nous conduit, dans la présente réflexion, à interroger les rapports entre le pouvoir, les richesses et la destruction qui en est constitutive
(I) A examiner la place qu’occupe-la torture dans le dispositif gouvernemental des régimes politiques africains actuels, en l’illustrant avec le cas de l’opposant politique camerounais Mamadou Mota
(II) A montrer pourquoi le commandement et le gouvernement doivent être au service de la modernisation de l’Afrique
(III) Et, tout en nous efforçant de caractériser les ressorts de l’intelligence politique du Prince
(IV) Nous allons boucler nos analyses en montrant en quoi l’exigence de prise en charge de la destination historique du peuple est attachée à la fonction gouvernante. Pouvoir, richesses et destruction
Remarquons d’entrée que, fondamentalement, le pouvoir politique est adossé à l’intégrité et à l’impuissance, voire à la destruction. Un véritable homme d’État ne décide pas de tout, suivant sa fantaisie ; il ne s’engraisse pas non plus au détriment de la population et de la fortune publique. Il n’administre pas au profit des siens, sa famille, son clan, ses partenaires, ses partisans, ses laudateurs, etc. Il arrive en revanche qu’il s’use à force de servir et d’engranger les résultats probants sur le chemin du développement économique et du progrès social.
En octobre 2018 par exemple, Ali Bongo, le Chef d’État du Gabon, a été victime d’un accident vasculaire cérébral à cause d’un excès de travail lié à la fonction présidentielle. Plusieurs fonctions motrices et neurologiques ont été endommagées et une partie de son corps est demeuré paralysé. Malgré un risque d’abîmer sa santé dans un exercice accru de ses fonctions, un Chef ne pense ni à lui en tant qu’individu devant nécessairement persévérer dans son être, suivant la loi de Spinoza, ni à ses réserves en tant que mammifère accumulateur-né : il se dépense sans compter pour la prospérité de tout le peuple. C’est pourquoi, chez les Beti, le concept de pouvoir est intimement articulé avec l’image de la destruction. La désignation d’un chef – un « nkumkuma » – est assimilée à l’apparition d’un champignon très rare appelé justement nkumkuma (nkum est un tronc d’arbre pourrissant et akuma signifie « richesses »).
Dans la science politique bantoue, Philippe Laburthe-Tolra l’a fort bien établi chez les beti, l’économie est articulée avec la politique. Le chef, le « nkukuma », est celui qui est très riche, d’abord en termes de nombre de sujets sur lesquels il exerce son autorité, mais aussi de richesses matérielles, qui ne lui appartiennent cependant pas ! Le chef est la matrice de la prospérité, le tronc qui porte la fortune publique en ses branches et ses racines. C’est pourquoi il met souvent sa fortune personnelle au service des besoins de ses concitoyens. Si un tel chef gouverne avec habileté et discernement, écrit Laburthe-Tolra, les siens connaitront le mvoe, la bonne santé au sens physique et social, la paix, l’équilibre.
Gouverner c’est aussi cela : rechercher l’équilibre, ce que certains bantous appellent « mvoe », qui résultera d’abord de l’harmonie avec les puissances invisibles en soi-même et dans la société. « En réalité, mvoe est le bon ordre dans sa plénitude, le but suprême pour l’individu comme pour la société – on pourrait presque dire « le bonheur », si le mot n’avait pris un sens si subjectif dans notre civilisation occidentale. Ici, ce bonheur n’est conçu que comme la conformité à un ordre naturel et social objectif, à une harmonie des choses ut sic, indépassable ».
De ce point de vue, rien n’est plus éloigné de l’esprit républicain que de gouverner avec le pernicieux sentiment que l’État est l’« elig mvamba » du Chef. Car qui cherche son propre salut et aspire en même temps au trône blesse la justice. En revanche, un chef avisé sent le péril imminent lorsque les institutions nationales prennent la coloration et l’odeur de ses origines biologiques, de ses racines tribales. C’est pourquoi il est impératif que le gouvernant sache se rendre digne de conduire le peuple, en restreignant lui-même sa puissance régnante ou, du moins, en se laissant contrôler et limiter son pouvoir par des mécanismes institutionnels éprouvés, au risque de basculer dans la tyrannie ou la folie de la torture.
II/ La torture dans le dispositif gouvernemental des régimes politiques africains actuels : le cas Mamadou Mota
Dans ses Entretiens, Confucius énonce le principe politique fondamental suivant : « Si le prince conduit le peuple au moyen de lois et le retient dans l’unité au moyen de châtiments, le peuple s’abstient de mal faire ; mais ne connaît aucune honte. Si le prince dirige le peuple par la Vertu et fait régner l’union grâce aux rites, le peuple a honte de mal faire, et devient vertueux ».
Tout se résume, en fait, à la force du discernement, à l’esprit de sacrifice et au sens de l’humanité entretenu par le prince. Mais que n’a-t-il anticipé l’avènement d’un prince au cœur étroit qui dirigerait en dehors des lois, avec une soif insatiable d’anéantissement de ses sujets en vue de sa survie politique propre et sans les rites d’exaltation de la conscience patriotique et de la destination historique du peuple qu’il sert ? Car en effet, en Afrique, il existe de tels régimes. Voici une illustration patente des dérives d’un pouvoir incapable de se restreindre dans les proportions exigibles par l’efficacité gouvernante, et qui confond enrégimentement de force des masses et gouvernement de la cité.
En effet, depuis que Maurice Kamto a revendiqué sa victoire à l’élection présidentielle de 2018 et à la suite des marches organisées par ses partisans, plusieurs membres du Mouvement de la Renaissance du Cameroun ont été arrêtés et emprisonnés dans d’autres pénitenciers de la Républiques. En fait, depuis le déclenchement de cette crise post-électorale, et même avant, les autorités politiques de Yaoundé – et une partie importante de l’opinion publique d’ailleurs – sont convaincues qu’elles sont victimes d’une entreprise planifiée de déstabilisation des institutions ourdie par les acteurs intérieurs et les puissances étrangères.
C’est ainsi qu’à la suite d’une mutinerie dans la prison de Kondengui, à Yaoundé, le 22 juillet 2019, plusieurs partisans de Maurice Kamto ont été sortis de prison vers une destination inconnue. En août 2019, ils sont ensuite apparus au tribunal d’Ekounou, à Yaoundé, où ils sont de nouveau jugés pour « rébellion en groupe, tentative d’évasion en coaction ; destruction en coaction, vol des effets d’anciens ministres, blessures simples, etc ».
Parmi les présumés coupables figure Mamadou Mota, Premier Vice-Président dudit parti politique. Devant la barre, ce dernier dont le bras gauche portait un plâtre et le bras droit était entravé par des menottes partagées avec un autre infortuné, avait sa tête est à moitié rasée, une large et fraîche cicatrice, issue d’une blessure suturée et visible même de loin.
Mota a fait la déclaration suivante, à l’intention du juge qui l’interrogeait : « Monsieur le Président du Tribunal, la personne qui comparaît devant vous est un ingénieur agronome. Je puis vous dire que ma présence ici n’est autre qu’un acharnement politique. Mon crime est d’être dans l’opposition et de critiquer le régime. Mais mon plus grand crime c’est surtout d’avoir fait des études. Vous voyez ce bras plâtré et cette tête cassée. Ce ne sont pas des bandits qui m’ont agressé, mais des gendarmes qui, méthodiquement, froidement, avec une violence et une rage folles, m’ont causé ces blessures, et ce ne sont pas les seules…En me frappant, ils disaient que cela m’apprendra à être opposant et à jouer à l’intellectuel, au lieu de me contenter d’être un petit gardien des maisons de leurs patrons. N’est-ce pas le sort d’un petit nordiste comme moi ? Que les femmes présentes dans la salle me pardonnent, mais vous devez savoir. Un gendarme m’a carrément dit “Mamadou Mota, le gros c ### de ta mère ».
Nous avons tous une mère, et des filles qui demain seront des mères. Que venait faire ma mère dans cette histoire ? Me torturer à mort ne leur suffisait-ils pas ? Ils m’ont fait dormir trois nuits au sol, sans mes habits qu’ils avaient pris le soin de déchirer, me privant pendant cette période de nourriture. Je suis un vrai miraculé.
C’est pour cela que devant vous, j’espère avoir droit à la justice. Car je n’ai commis aucun crime. J’avais été appelé ce 22 juillet pour calmer les protestataires. Ce que j’ai fait. Et alors que je dormais déjà, en pleine nuit, ils sont venus me sortir de la cellule, et dès la Cour intérieure de la prison, c’est des gardiens de prison qui ont entrepris de me molester. Je ne suis donc coupable de rien. Par ailleurs, je ne suis pas en état d’être jugé maintenant.
L’urgence c’est de recouvrer ma santé » (propos rapportés par son avocat, Maître Emmanuel Simh).
Quelle pratique originale du concept d’État de droit ? Et quelle étrange réaction que celle du pouvoir ainsi désigné, qui consiste à se barricader et à s’aliéner le soutien précieux de la population, des forces vives de la nation et de la masse critique en entretenant la guerre dans certaines régions du pays et en s’adonnant à des actes innommables de torture systématique des citoyens ! Un pouvoir qui manque aussi officiellement de retenue et d’hygiène au point d’affamer, de maltraiter et de torturer ses citoyens non armés, sous le prétexte malicieux du maintien de l’ordre public, est-il irrémissible de cette ignominie ?
Un tel prince s’est-il arrêter à considérer le préjugé rigide et surfait suivant lequel « il est impossible de plaire aux hommes de notre époque, et très difficile d’échapper à la haine et à l’envie » ? Peut-il, dès lors, s’épargner l’animosité viscérale d’une partie importante de la population et éviter d’être honni et combattu suite à ces forfaits abjects ? Car enivrés de leurs victoires sur l’opposition politique, les acteurs du régime en place ignorent les leçons de l’imprévisibilité de l’histoire. L’humilité, la sagesse et l’expérience dans les drames de l’Histoire humaine commandent pourtant de se raviser.
Le sage dit : « Vainqueurs, n’oubliez pas que les victoires humaines ne sont jamais que partielles et temporaires. Rien, dans les affaires de ce monde, ne saurait être réglé pour toujours. Aucun triomphe ne détermine l’avenir lointain» !
C’est sans doute pourquoi les peuples, même au plus fort de la répression et des purges les plus sanglantes, ont toujours su vaincre la peur et retrouver l’itinéraire de leur destination historique. Aux sanglots insoutenables qu’ils répriment dans leurs poitrines meurtries, les citoyens opposent les flots mélodieux de leur trajectoire d’affirmation politique, économique et culturelle qu’il s’enracine dans le granit des révolutions. Ils savent que la stratégie des gouvernants-imposteurs est éprouvée : distiller l’effroi et décourager.
Le but ultime est de verrouiller les terrains social, politique et économique, pour qu’aucune énergie nouvelle ne surgisse, pour pérenniser ainsi le statut quo et entretenir la misère afin de se maintenir au pouvoir à travers la distribution quotidienne des pains, des boites de sardines et des pagnes surfacturés. Il faut ajouter, à cet égard, qu’ils recrutent de petits serpenteaux chômeurs et des universitaires bien repus, aussi venimeux que vaniteux, pour prêcher l’éducation civique du village et des morales d’enlisement et d’auto-anéantissement. C’est le socle imparable de leur jouissance quotidienne ; c’est la condition sine qua non de leur survive politique.
Dans tous les cas, ce témoignage glaçant remet au goût du jour la question centrale des principes, des modalités et des enjeux du gouvernement civil dans les États modernes, ceux des pays africains en l’occurrence, où il est courant de confondre commandement des hommes et gouvernement de la cité.
III/ Le commandement et le gouvernement au service de la modernisation de l’Afrique
Il faut pourtant distinguer, ainsi que l’indique André Maurois dans Un art de vivre, l’art de commander et l’art de gouverner : « Gouverner et commander sont, en temps de paix, deux arts distincts. Commander, c’est conduire un groupe d’êtres humains, soumis au chef par une discipline, vers un but défini. […] Mais le Chef de gouvernement d’un État libre doit, lui, diriger, vers des objectifs embrumés et mouvants, les actions d’un groupe que rien ne contraint à lui obéir (sinon la crainte de l’anarchie, crainte qui, dans les périodes de bonheur, s’assouplit) ».
Commander revient précisément à définir les objectifs, la trajectoire et des tâches y afférentes et ordonner que l’ensemble des membres du groupe dont a la charge les suivent fidèlement ; gouverner, par contre, consiste à maintenir le peuple dans la voie droite, suivant les prescriptions des lois en vigueur dans le pays et l’ordre le plus à même de favoriser la prospérité, sans personnifier la rectitude exigée à tous. Le problème est que dans nos pays, nous ne savons plus exactement si nous sommes en temps de paix ou en temps de guerre.
Certains ministres, directeurs généraux, officier supérieurs d’armée, bureaucrates et autres hauts cadres de l’administration publique, qui pensent, à tort, que rien n’est au-dessus des amitiés et des affinités, considèrent d’ailleurs que « tout notre travail consiste à être en repos » ! Mais au travers de cette devise des artistes de génie, il faut voir, dans la remarque de Gœthe, la reconnaissance d’un travail préalable et acharné de celui-ci en amont de la production de ses chefs-d’œuvre. Le repos de l’artiste est donc la restitution de sa vie intérieure, qui est riche des expériences diverses (une longue pratique dans les arts, des échanges épistolaires ou une mutualisation des pratiques avec les pairs, réminiscences, etc.) qui ont forgé son style.
Cette devise ne convient donc pas aux acteurs politiques et aux hommes d’État qui, eux, sont le produit de leur engagement quotidien, de leurs conquêtes futures momifiées dans leurs ambitions. Par contre la célérité et le professionnalisme dans le traitement des dossiers à lui soumis, l’énergie, l’assurance et le dévouement dont il fait montre dans la conduite et l’exécution des projets dont son administrations a la charge, la volonté et le talent manifesté dans la conception d’une vision de la destination collective adossée sur un dessein noble, sont autant de qualités qui distinguent l’authentique administrateur du fonctionnaire budgétivore, l’homme d’État représentatif et l’imposteur qui parasite les circuits de décision étatiques.
Si, du bout des lèvres, de tels ministres reconnaissent le prince comme leur créateur, ils ne manquent pas de le maudire en pensée, comme l’archevêque mécréant et infidèle de Cambray, Dubois, dont Saint-Simon écrit : « Tous les vices combattaient en lui à qui en demeurerait le maître. Ils y faisaient un bruit et un combat continuel entre eux. L’avarice, la débauche, l’ambition, étaient ses dieux ; la perfidie, la flatterie, les servages, ses moyens ; l’impiété parfaite, son repos ; et l’opinion que la probité et l’honnêteté sont des chimères dont on se pare, et qui n’ont de réalité dans personne, son principe, en conséquence duquel tous moyens lui étaient bons. Il excellait en basses intrigues, il en vivait, il ne pouvait s’en passer, mais toujours avec un but où toutes ses démarches tendaient, avec une patience qui n’avait de terme que le succès, ou la démonstration réitérée de n’y pouvoir arriver, à moins que, cheminant ainsi dans la profondeur des ténèbres, il ne vit jour à mieux en ouvrant un autre boyau. Il passait ainsi sa vie dans les sapes.
Le mensonge le plus hardi lui était tourné en nature avec un air simple, droit, sincère, souvent honteux. Il aurait parlé avec grâce et facilité, si dans le dessein de pénétrer les autres en parlant, la crainte de s’avancer plus qu’il ne voulait, ne l’avait accoutumé à un bégaiement factice […]. Sans ses contours et le peu de naturel qu’il perçait malgré ses soins, sa conversation aurait été aimable. Il avait de l’esprit, assez de lettres, d’histoire et de lecture, beaucoup de monde, force envie de plaire et de s’insinuer, mais tout cela gâté par une fumée de fausseté qui sortait malgré lui de tous ses pores et jusque de sa gaîté qui attristait par là. Méchant d’ailleurs avec réflexion et par nature, et par raisonnement, traître et ingrat, maître expert aux compositions des plus grandes noirceurs, effronté à faire peur étant pris sur le fait ; désirant tout, enviant tout, et voulant toutes les dépouilles.
On connut après, dès qu’il osa ne plus se contraindre, à quel point il était intéressé, débauché ; inconséquent, ignorant en toute affaire, passionné toujours, emporté, blasphémateur et fou, et jusqu’à quel point il méprisa publiquement son maître et l’Etat, le monde sans exception et les affaires, pour les sacrifier à soi tous et toutes, à son crédit, à sa puissance, à son autorité absolue, à sa grandeur, à son avarice, à ses frayeurs, à ses vengeances » Je cite long. Il le faut. Car tel est, sous la plume de Fénélon, le portrait saisissant des ministres sans scrupule, qui savent provoquer la ruine d’une nation.
L’enflure de la suffisance, la fierté et la pompe du serviteur de l’État sans cœur ne peut être que cause de la perpétuation concomitante d’inepties, du faste dédaigneux, de la brimade et de l’usurpation ; ce qui ne conduit qu’à un odieux trépas et de l’agent public et de l’institution concernée.
À ce sujet, la question de la gestion des renseignements est centrale dans le dispositif de gouvernement en place. André Maurois, s’appesantissant sur la manière dont un chef doit gérer les renseignements qu’il reçoit, note : « Tous les renseignements sont faux. […] Presque tout est exagéré, déformé, supprimé. Le seul moyen de n’être pas trompé sur les faits, c’est d’aller de temps à autre voir soi-même. La menace de telles visites suffit à faire merveille. Soudain les rapports deviennent véridiques » Gouverner n’implique donc pas que l’on dirige par procuration, par épisode, par délégation de signature permanente.
D’un autre côté, puisqu’en démocratie le leadership n’est pas institué suivant les critères de primogéniture, il faut que le chef qui gouverne, surtout s’il est d’un certain âge, répugne à l’attrait du sentimentalisme dont sont attachées les affinités héréditaires et les options aristocratiques. En ce sens l’appartenance à une organisation mystique ou ésotérique ou l’origine familiale, fût-elle de grande réputation, ne devrait en aucun cas influencer ou conditionner la désignation à un poste de responsabilité. Et puisqu’il n’obéit pas aux vicissitudes des états d’âme et aux intempéries des humeurs, « un chef peut, et souvent doit être sévère ; il n’a pas le droit d’être méchant, ni cruel, ni rancunier. Il doit mépriser les ragots, mais, s’il le peut, diriger les courants d’opinion qui le portent ».
Malheureusement, au lieu de laisser agir et de se contenter de vérifier, on fait au contraire tout dépendre de la personne faillible du leader, de la petite âme du Chef ; au lieu d’imposer aux intérêts particuliers, irréductibles d’apparence, le respect de l’intérêt général, on laisse les lobbies, des castes de prébendiers et la mafia dépecer minutieusement l’État. Or, ce qui distingue vraiment un homme d’État, c’est d’une part sa patience alternée à une rapidité exécutive dans la démolition du gîte national de la misère, et d’autre part l’édification des poutres qui portent la prospérité de son peuple.
Ce qui exige une grande humilité, une détermination d’airain et beaucoup d’esprit qui s’accommode du péril de disparaître à tout moment et, donc, de se voir succéder à la tête de l’État par un membre de son entourage. Car, nul ne peut honorer les esprits s’il n’est capable de remplir correctement ses devoirs envers les hommes.
IV/ L’intelligence politique du Prince
De ce point de vue, celui qui aspire gouverner dans les règles de l’art le traduit d’abord par sa propension à s’effacer pour faire place à ses ministres et représentants, c’est-à-dire à ses potentiels remplaçants. C’est cela avoir le sens des possibles : d’un côté mettre toute sa force, ses compétences et ses espérances dans la balance du pouvoir pour impulser la transformation sociale exigible ; d’un autre côté, prévoir et anticiper son incapacité en tant qu’être humain originellement limité. Un chef avisé et intègre sait qu’il est à la tête d’une équipe ; il ne songe pas qu’il est le messie indispensable qui ne viendra plus. Se méfier de tous ses ministres, manquer totalement de confiance à l’égard de tous les collaborateurs, sans exception, être incapable d’identifier ou de produire un ou plusieurs membres de son équipe gouvernemental capables de prendre le relais après sa disparition, est un aveu cinglant d’échec de la part d’un Chef d’État.
Pis, pour un régime en place, dédaigner à constituer une classe dirigeante capable de prendre les rênes du pouvoir à la suite de son règne équivaut à rien de moins qu’à un acte de haute trahison.
C’est pourtant le propre des régimes autocratiques. Ici, le Chef n’est ni éclairé ni engagé véritablement. Au contraire, il se referme sur les flots de louanges médiatiques qui produisent au quotidien son rayonnement et sur les épanchements de la vanité que ses laudateurs les plus fervents oignent en permanence sur sa suffisance constitutive. Le protocole attaché à la fonction suprême ne sert dès lors plus qu’à entretenir les effluves d’une solennité de façade.
À l’occasion des grandes parades. Le Chef oublie de se retrouver avec soi, dans le silence rythmé de l’auto-évaluation du degré d’estime que lui porte le peuple, ou pour inspecter les réalisations produites sous son leadership. Il s’attache plutôt à mieux ses soustraire à ses devoirs, à se dissimuler de soi. D’où son incapacité à se retrouver avec soi, en remettant en question des orientations politiques et économiques inopérantes et contre-productives sur lesquelles les citoyens pestent et qui carburent leur ressentiment à son égard.
Dans ce cas, ce n’est pas tant les qualités personnelles intrinsèques du Chef d’État qui sont remises en cause, mais sa disponibilité à se ressourcer auprès de la pensée critique. Jean-Bedel Bokassa, autoproclamé Empereur à vie en République centrafricaine, s’est révélé être trop immature, trop amoureux des valeurs factices, des honneurs prématurés ; il s’est dévoilé sous les traits d’un sujet parvenu et trop anti-patriotique, anormalement nombriliste. Sa chute fut retentissante, et ses turpides politiques, mémorables.
Pour prévenir de tels anachronismes, l’État doit, entre autres, concevoir une politique de formation des entrepreneurs et des cadres supérieurs, bâtir une société performante et démocratique, et avoir de grandes ambitions au plan international. En effet, un pays qui veut satisfaire les besoins de ses citoyens ne peut s’empêcher de mettre sur pied des institutions défiées à la tâche d’élever la conscience politique des jeunes, non seulement en stimulant leur capacité à prendre des initiatives personnelles dans leur vie, mais aussi en les préparant à l’exercice des hautes fonctions publiques, formation au cours de laquelle ils devront progressivement adopter, dès la plus tendre enfance, des comportements éthiques et républicains.
Par ailleurs, les autorités publiques doivent entreprendre de moderniser l’organisation sociale, restaurer la culture nationale et restructurer le droit constitutionnel et la juridiction pénale. Gouverner, dès lors, se résume à une certaine intelligence du monde ; ce qui implique, à ce niveau supérieur de responsabilités, aussi bien une connaissance approfondie de la stupidité des hommes et une pratique exercée et patiente de leurs intrigues, qu’un effort pour contenir l’imprévisibilité du hasard à sa portion congrue, ainsi qu’une expérience dans la gestion des intérêts vitaux des États.
C’est pourquoi, à la question de savoir ce qui est attendu du Prince pour que son peuple le respecte et lui soit fidèle et loyal, le Sage répond :
« Que le Prince montre de la dignité, et il sera respecté ; qu’il honore ses parents et soit bon envers ses sujets, et ses sujets lui seront fidèles ; qu’il élève aux charges les hommes de mérite et forme les incompétents, et il excitera le peuple à cultiver la vertu ».
On comprend donc que le choix du leader, son degré de prise de conscience de ses devoirs, son courage moral en un mot, et son honnêteté financière qui garantit après coup sa respectabilité, soient déterminants, tout comme son caractère même, qui, d’ailleurs, prend corps dans sa passion de réussir son œuvre, à savoir, rendre son pays riche et puissant. À cet égard, c’est un singulier paradoxe politique s’il est démontré que le Prince est malhonnête et fourbe ; s’il s’avère qu’il est frivole, lâche, impie, cruel et débauché ; s’il est établi qu’il a trahi son serment et violé les lois qu’il était censé appliquer.
V/ Gouverner, c’est prendre en charge la destination historique d’un peuple
Les peuples qui réussissent la transformation qualitative de leurs structures mentales, sociales et infrastructurelles sont ceux qui refondent en permanence leur édifice philosophico-idéologique.
Ceci s’est vérifié avec les pays européens, l’Amérique du Nord, les pays d’Asie du Sud-Est, la Chine, l’Inde, etc. Pour conduire cette tâche de refondation politique systématique, trois conditions sont requise : d’une part, le Chef doit avoir la légitimité nécessaire qui fonde son autorité, en somme, il doit se présenter sous les traits d’un visionnaire appliqué et intègre ; ses ministres et lui doivent avoir une haute idée de leurs fonctions et des compétences managériales requises pour ces charges publiques exigeantes ; le peuple doit être mobilisé pour l’entreprise gigantesque de développement économique, dans la discipline, la paix et la justice sociale.
Dans le cas du Cameroun, ce que Marcien Towa redoutait, à savoir, l’institution d’une société privilèges, d’oppression et d’exploitation, s’est finalement matérialisé dans notre pays sous les traits les plus abjects. Nous sommes donc en crise. Et en temps de crise, les cadres de la normalité politique sont éclatés. « Que les hommes politiques, gâtés par des années d’intrigues, que les journalistes, déséquilibrés par toutes les compromissions du métier, puissent accepter les plus impudents mensonges, se boucher les yeux à d’aveuglantes clartés, cela s’explique, se comprend », explique Émile Zola dans sa Lettre à la jeunesse. Mais faire la politique ne revient pas à embrasser la carrière du crime, ni à aménager dans le no man’s land de la pauvreté des oasis de la prévarication et de l’assassinat économique.
L’arène politique n’est ni un repère pour brigands en costumes ni un sanctuaire pour les criminels en cravates. Le champ politique n’est pas l’occasion offerte aux festivaliers de l’ordure pour répandre dans l’espace public la nausée et les vomissures qui l’accompagnent, ni non plus le festin des ogres assoiffées de l’avenir des jeunes et de la tranquillité des vieux respectables.
Certes, les traîtres ne manqueront pas à l’appel : les Verrès, les Catalina, les Vargunteius et les Céthégus sont citoyens du monde…. Mais le gouvernant ne doit point manquer à l’obligation de communiquer la douceur de la patrie au peuple à travers sa voix.
La démocratie, c’est le nom qu’on donne au travail qu’un peuple fait pour atteindre sa destination historique. Pour ce faire, chaque citoyen doit apprendre à mesurer ses responsabilités (comprendre, assumer ses devoirs et défendre ses droits) et se rendre utile à la communauté. Être d’utilité publique, c’est se constituer républicain. Et Wolff définit la république comme « un certain nombre d’hommes occupés à l’avancement du Bien public », le Bien public étant entendu comme ce qui « renferme la plus grande félicité dont chaque homme puisse jouir sur la terre, comme conformément à son état ».
Or, s’il est admis que dans la République, les citoyens agissent selon les lois, il faut convenir que pour gouverner, même à la plus petite échelle d’une commune, il faut remplir deux conditions au moins : 1/ d’abord, être instruit des ingrédients qui rentrent dans la recette du bonheur de ses administrés ; 2/ ensuite, cultiver la force de sa volonté en vue d’accomplir fidèlement la mission du développement et d’épanouissement qui nous échoit, et ainsi impulser les changements nécessaires à la félicité de la communauté entière.
C’est aussi dans cette optique que s’inscrit le processus de décentralisation.
Elle consiste en une grande rationalisation du développement au plan local. Elle impose une nouvelle grammaire de l’action publique. Dans cette approche, tout raisonnement porte sur une difficulté donnée à vaincre et préfigure une action à entreprendre. Or, quoique le bonheur soit générique à l’espèce humaine en général, ses modalités divergent suivant qu’il s’agit d’un enfant, d’une femme ou d’un homme. On comprend donc que, quelles que soient la qualité de son instruction, ses compétences et sa probité, l’élu suprême ne puisse conduire seul le chantier de l’épanouissement de tous.
Gouverner, ce n’est pas l’affaire d’un homme ; c’est le dispositif d’un Conseil, d’une Collégialité, d’une mobilisation générale de tous les villageois, de tous les chômeurs, de tous les fonctionnaires, de tout le peuple qui, en cœur, entonnent le refrain de l’exorcisation collective, brisent les chaînes de l’enlisement et se saisissent de leur destination historique en pleines mains.
Fridolin Nke,
Expert du discernement
Université de Yaoundé I
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.