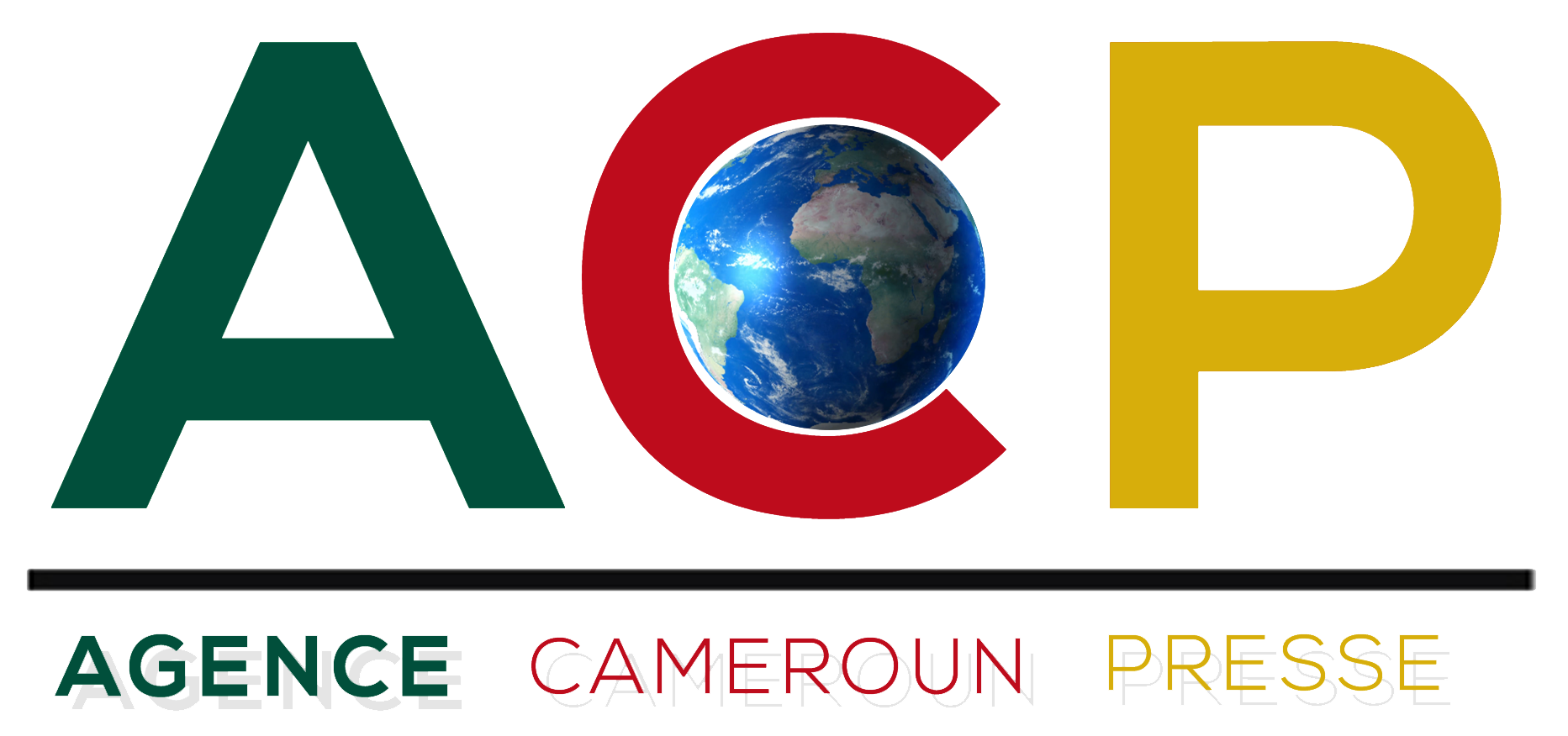Armand Leka Essomba, Sociologue, Laboratoire camerounais d’études et de recherches sur les sociétés contemporaines à l’Université de Yaoundé I nous replonge entre autres dans ce « sombre passé ».
« Ruben Um Nyobè, secrétaire général de l’Union des Populations du Cameroun, avait été abattu le 13 septembre 1958, en début d’après-midi, par les troupes françaises chargés de mettre fin à l’insurrection organisée dans la région de la Sanaga-Maritime depuis 1955 par le mouvement qu’il dirigeait.
C’était quelques secondes seulement après que la troupe eut tué un de ses aides, Pierre Yém Mback. En effet, en raison des indiscrétions de « ralliés », son campement avait été localisé au début du mois de septembre par le capitaine Agostini, officier de renseignements, et par l’inspecteur de la sureté, M. Conan. Au petit matin du samedi 13 septembre 1958, un détachement opérant par petites équipes de quatre à cinq hommes avait entrepris la fouille systématique des environs de Boumynébel, petite agglomération située sur la route Douala-Yaoundé. Un groupe parti du village de Libel li Ngoy comprenait en outre quelques « ralliés » et un certain nombre de prisonniers dont Esther Ngo Manguèlè, que l’on soupçonnait d’avoir travaillé comme agent de liaison du « grand maquis ».
Des renforts militaires étaient arrivés de Makai. D’autres avaient traversé la rivière Pugè, venant de Njok Nkong. La troupe, au complet, se retrouva au pied d’une colline située près du campement de Um. Après avoir bouclé l’ensemble de la zone, elle entreprit une chasse à l’homme, aidée des « pisteurs », des « ralliés » et des prisonniers. Elle ne mit pas longtemps avant de retrouver les traces des chaussures que portait Um.
Conscient du danger, et sur l’insistance de son entourage, ce dernier avait quitté son maquis, probablement la veille. Il se dirigeait alors vers un nouvel emplacement dont, prétendait-on, Alexandre Mbénd avait entrepris l’aménagement. Mais celui-ci traînait en longueur. Um et ses compagnons choisirent donc d’attendre près d’un rocher que jouxtait un marigot. Dans le maquis, ce matin-là, Mayi Matip avait procédé à une consultation oraculaire. Selon ses dires, aucun augure ne prévoyait de catastrophe.
La patrouille accéléra le pas. Très vite, elle repéra le groupe. En faisait partie Martha, la compagne de Um dans le maquis. Celle-ci portait un enfant, Daniel Ruben Um Nyobè. Il y avait aussi Um Ngos, le gardien du grand maquis, Pierre Yém Mback, le secrétaire, Yèmbèl Nyébél, l’agent administratif, Ruth Poha, la belle-mère de Um, et Ruben Um Nyobè lui-même. Aussitôt, les fusils se mirent à crépiter. Yém Mback fut atteint le premier. Les militaires, dont un conscrit tchadien, Sara Abdoulaye, tiraient dans tous les sens.
Les « pisteurs » n’avaient pas reconnu Um d’emblée. Dès que la fusillade éclata, Yém Mback tombant presque à ses pieds, Um s’efforça d’enjamber un tronc d’arbre qui l’empêchait de contourner le rocher et de s’enfuir. C’est alors qu’un des guides, Makon ma Bikat, le désigna à la troupe. Abdoulaye tira et l’atteignit de dos. Um s’écroula, laissant tomber non loin de là une serviette renfermant quelques documents et des carnets où il notait ses songes, puis mourut en râlant.
La profanation d’un cadavre
Le cadavre de Um fut transporté à l’hôpital public de la ville, où le médecin Ntimban effectua les examens nécessaires pour dresser un constat de décès. Puis on exposa le mort dans l’une des salles ordinairement prévues pour accueillir les malades.
Entre-temps, les autorités avaient procédé à la publication et à la diffusion d’un tract annonçant la chute du « Dieu qui s’était trompé ». Tiré à plusieurs milliers d’exemplaires, ce tract fut distribué dans la plupart des grands centres urbains du Sud-Cameroun situés le long du chemin de fer. Il représentait une photographie de Um vaincu par la mort et étendu au sol.
Alors que le cadavre était exposé à l’hôpital, Jacques Bitjoka-un des principaux chefs des milices dites d’auto-défense que l’administration avait organisées et financées pour contrer l’U.P.C. tenta de le profaner. Il l’abreuva d’insultes, frappa le front du mort de son index droit, et mit ce dernier au défi de se mettre debout et de se mesurer à lui dans un duel dont, assurait-il, lui, Bitjoka ne pouvait que sortir vainqueur. Certes, on ne pouvait pas faire disparaître entièrement le corps. Mais l’idée de lui trancher la tête et d’en retirer le cerveau afin de l’examiner fut avancée. Le cérémonial de l’enterrement fut à l’image des reprouvés. Les familles ne furent pas invitées. On exigea des gens qu’ils s’abstiennent de toutes lamentations, même si la consigne ne fut point totalement respectée.
Le pasteur Song Nlend (de la mission presbytérienne américaine) assura une brève cérémonie. Les rites appropriés pour le genre de mort auquel Um avait succombé (nyèmb matjel) ne furent cependant pas respectées. L’on ne questionna point le mort. On n’offrit pas de repas. Rien ne fut expliqué. Il ne fut certes pas privé de sépulture.
Mais, sur recommandation formelle des autorités de l’Etat, on immergea son corps dans un bloc massif de béton enfoui dans le sol. Pour mesurer l’ampleur du drame symbolique que constitua l’enterrement de Um, il importe de rappeler qu’il fut assassiné pour s’être opposé sans compromis au régime colonial et pour avoir résisté à la corruption à laquelle recourait l’administration pour vaincre moralement les africains qui osaient se dresser contre elle. Il échappa aussi à l’exécution publique à laquelle l’Etat colonial avait coutume de condamner les dissidents (cas de Douala Manga Bell et de Martin-Paul Samba en 1914).
Compte tenu du fait qu’il avait, de son vivant, attenté à la vie à l’ordre, l’Etat voulu organiser son enterrement comme une tentative de réparation de ce même ordre (…). En jouant sur les images de l’ordre et du désordre à travers la manière même de l’enterrer, l’on cherchait à retirer à cette mort ce qui qui la rendait parlante. L’Etat colonial voulu donc faire taire le mort. Et il s’y prit de plusieurs façons.
D’abord, de la brousse où il fut abattu jusqu’au village de Liyong où les paysans l’identifièrent, on traina le cadavre dans la boue. Cela le défigura, sa peau, sa tête, ses cheveux et son visage ayant été profondément déchirés. Um perdit donc sa figure singulière, la netteté de ses traits, ses formes distinctives, bref, son aspect humain. En défigurant le cadavre, on voulut détruire l’individualité de son corps et le ramener à une masse informe et méconnaissable. Il eut ensuite l’outrage perpétré par Bitjoka. Cet outrage répondait à un souci. Puisque nul n’avait réussi à humilier ce mort de son vivant, il fallait déshonorer sa dépouille, en lui barrant physiquement l’accès au statut de mort glorieux que sa vie, son témoignage et le drame de sa fin lui avaient mérité. C’est dans le même esprit qu’on ne lui accorda qu’une tombe misérable et anonyme. Aucune épitaphe, aucun signalement particulier n’y furent inscrits. Puisqu’il fallait nier tout ce dont sa vie témoignait en en faisant un mort sans visage, rien ne devait subsister qui fit briller sur ce cadavre, un dernier reflet de vie.
Comme pour atteindre le comble, on l’enterra immergé dans un bloc de massif de béton. L’Etat colonial cherchait ainsi à brouiller définitivement les liens de Um avec le sol où il reposait, et où, selon le principe de l’autochtonie propre à la société dont il descendait, se perpétuaient ses rapports avec sa lignée, sa descendance. Il s’agissait, au total, d’effacer Um de la mémoire des hommes en le renvoyant au chaos où il ne serait plus strictement personne.
Lorsqu’en 1960 l’indépendance pour laquelle il avait milité et pour laquelle il fut tué échut finalement aux forces qui en avaient combattu le principe, l’Etat postcolonial veilla à ce que qu’aucun dispositif de mémorisation ne rappelle ce mort ».
Testament post mortem
Que retenir à la lecture de ce récit épique, et surtout quelles conséquences pourrions-nous en tirer ?
Simplement, que l’on peut sans doute assassiner un homme et profaner un cadavre, mais que nul ne peut ni censurer, ni emprisonner, encore moins assassiner l’imaginaire et profaner durablement la mémoire. Um Nyobè fut un patriote sincère ainsi qu’un nationaliste intègre. La haute idée qu’il avait du destin de son pays est appelée à inspirer encore pour longtemps ses descendants. Par descendants, je ne parle point du petit groupe de comédiens qui, depuis une vingtaine d’années, se disputent bruyamment et sans remord, sa dépouille politique, au risque de faire croire à la multitude que ce patriote africain serait la propriété privée d’un village.
Je parle de tous les citoyens camerounais d’abord, auxquels il enseigna que notre destin dans le monde n’était point de vivre courbé.
L’auteur de ces lignes demeure fasciné par la vive et précoce intelligence de cet homme. Au panthéon des héros africains, sa préséance ne fait pas de doute à mes yeux. Il nous faudra toutefois se garder d’établir complètement avec cette figure, cette sorte de relation quasiment religieuse, qui nous empêcherait d’approfondir les raisons pour lesquelles, l’utopie qu’il porta si intensément jusqu’en septembre 1958, échoua à s’accomplir, au-delà de la cruauté idiote d’un colonialisme criminel que la France incarna de la manière la plus grotesque et la plus inhumaine… ».
N.R.M